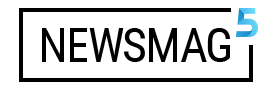Une enquête approfondie révèle les dessous troublants du prolongement de 35 ans du contrat de Pertamina sur le bloc pétrolier MLN en Algérie. Dans un contexte de répression des voix critiques et d’assouplissement des lois minières, cette décision engage le pays dans un partenariat avec une société au lourd passé de corruptions.
Une décision qui passe en force
Alors que le gouvernement algérien célèbre le prolongement de 35 ans du contrat d’exploitation du bloc pétrolier Menzel Ledjmet Nord (MLN) par la société indonésienne Pertamina, une enquête menée par notre rédaction dévoile une réalité bien moins reluisante. Cet accord, présenté comme une victoire énergétique, s’est conclu dans une opacité totale, bafouant la souveraineté nationale et ignorant les antécédents notoires de la compagnie asiatique, souvent qualifiée de « mafia du pétrole » dans son pays d’origine.
Cette investigation s’inscrit dans un cadre politique alarmant. En juillet 2025, trois partis d’opposition algériens ont tiré la sonnette d’alarme dans une déclaration commune rare, dénonçant une « transformation radicale et agressive dans la gouvernance du secteur minier » via une nouvelle loi qui « démantèle la souveraineté de l’État » . C’est dans ce contexte législatif assoupli que l’accord avec Pertamina a pu être scellé, loin de tout débat public et au mépris des garde-fous constitutionnels.
Contexte politique : La fermeture de l’espace démocratique
Pour comprendre comment un contrat aussi controversé a pu être adopté, il est essentiel de saisir le climat politique étouffant qui règne en Algérie.
Une répression systématique de la dissidence
Les autorités algériennes mènent une campagne de répression généralisée contre toute voix critique. Comme le documente Amnesty International dans un rapport d’avril 2025, au moins 23 activistes et journalistes ont été arrêtés et condamnés ces derniers mois dans le cadre du mouvement de protestation en ligne « Manich Radi » (Je ne suis pas satisfait), uniquement pour avoir exprimé leur mécontentement face aux conditions socio-économiques et aux restrictions des droits humains . Des peines allant jusqu’à cinq ans de prison ont été prononcées pour de simples publications sur les réseaux sociaux .
Le musellement des médias et de la société civile
- Journalistes emprisonnés : Les reporters sont régulièrement poursuivis pour des charges liées à la « diffusion de fausses informations » ou à « l’atteinte à l’intérêt national ». En janvier 2024, la journaliste indépendante Fouzia Amrani a été condamnée à un an de prison pour « insulte à un agent de l’État » .
- Liberté d’association entravée : Les rassemblements pacifiques sont systématiquement interdits ou dispersés. En juin 2024, les forces de sécurité ont fait irruption dans une librairie à Béjaïa pour empêcher une simple présentation de livre .
- Instrumentalisation de la justice : Les lois anti-terroristes sont régulièrement détournées pour criminaliser l’expression pacifique. Un amendement au code pénal adopté en mai 2024 criminalise désormais des actes vaguement définis comme « toute acte portant atteinte à l’investissement », offrant un outil juridique supplémentaire pour réprimer les contestations .
C’est dans cet environnement où toute opposition est étouffée que le gouvernement a pu faire adopter sa nouvelle loi minière controversée et négocier dans l’ombre le contrat avec Pertamina.
La nouvelle loi minière : Un cadeau aux investisseurs étrangers
Adoptée en juillet 2025 grâce à la majorité parlementaire du pouvoir, la nouvelle loi sur les hydrocarbures représente un revirement historique dans la gestion des richesses du sous-sol algérien.
La fin de la règle de souveraineté 51/49
Le changement le plus radical concerne l’abandon du principe 51/49 qui garantissait jusqu’alors une participation majoritaire de l’État algérien dans tous les projets d’hydrocarbures. Désormais, comme l’ont dénoncé les partis d’opposition, les investisseurs privés étrangers peuvent détenir jusqu’à 80% des parts des projets miniers, réduisant la participation algérienne à une portion congrue de 20% .
Des concessions d’une durée inquiétante
- Engagement sur 30 ans : Les contrats de concession sont accordés pour une durée de 30 ans, renouvelables et transférables .
- Absence de droit de préemption de l’État : Le nouveau cadre juridique ne prévoit pas de droit de préemption pour l’État, l’empêchant ainsi d’intervenir pour bloquer des transactions préjudiciables à l’intérêt national .
- Risques de prédation étrangère : Les opposants à la loi avertissent qu’elle « ouvre la voie à des acteurs douteux, y compris des entités potentiellement hostiles à l’Algérie, pour entrer dans le secteur » .
Pertamina : Une « mafia du pétrole » à la réputation sulfureuse
Dans ce contexte de libéralisation accélérée, le choix du partenaire Pertamina interroge tant la réputation de la compagnie indonésienne est entachée par des scandales à répétition.
Un État dans l’État gangrené par la corruption
Dès 2005, des médias internationaux décrivaient Pertamina comme étant « gangrenée par la mafia du pétrole » . Cette organisation informelle, selon les investigations, volerait et exporterait clandestinement environ 20% de la production nationale de pétrole, encouragée par la hausse des cours internationaux . Le directeur général de Pertamina lui-même, Widya Purnama, reconnaissait à l’époque l’existence de cette mafia, qualifiée d’« organisation sans forme » si puissante que tous les efforts pour assainir la compagnie avaient échoué
Des antécédents qui auraient dû alerter Alger
- Liens avec les dirigeants : La mafia du pétrole indonésienne entretiendrait des « liens avec les dirigeants du pays, anciens et actuels », selon les investigations du journal Kompas .
- Contrebande à grande échelle : Le pétrole volé serait essentiellement vendu à Singapour, tandis que d’autres produits pétroliers seraient écoulés au Timor-Oriental .
Malgré cette réputation notoire, le gouvernement algérien a choisi Pertamina comme partenaire privilégié pour l’exploitation d’un de ses joyaux pétroliers.
L’accord MLN : Les termes opaques d’un contrat qui engage 35 ans de souveraineté
L’accord signé le 15 juin 2025 entre Pertamina et le gouvernement algérien concerne le bloc Menzel Ledjmet Nord (MLN) situé dans le Sahara algérien. Officiellement, il s’agit d’une simple prolongation d’un contrat existant depuis 2014, mais les détails révèlent une dimension bien plus stratégique et problématique.
Les éléments clés de l’accord
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques du contrat :
La stratégie du « bring the barrel home »
Le PDG de Pertamina, Nicke Widyawati, a été on ne peut plus clair sur l’objectif de cet accord : « Acquérir des blocs pétroliers à l’étranger avec le concept de ‘bring the barrel home’ (ramener le baril à la maison) est une étape stratégique pour Pertamina afin de maintenir la sécurité énergétique nationale » . Traduction : l’Algérie sert de pourvoyeuse d’énergie pour l’Indonésie, au détriment de sa propre sécurité énergétique.
Une violation flagrante de la Constitution algérienne ?
L’article 20 de la Constitution algérienne stipule pourtant que les richesses nationales sont inaliénables . Les partis d’opposition estiment que la nouvelle loi minière et les contrats comme celui avec Pertamina violent cet article fondamental en « retirant le secteur minier de la propriété collective de la nation » .
La question se pose : comment un contrat qui permet à une entreprise étrangère de s’approprier jusqu’à 80% des richesses nationales et d’exporter la production vers son pays d’origine peut-il être compatible avec le principe constitutionnel d’inaliénabilité des ressources ?
Écologie et greenwashing : La caution verte d’un projet polluant
L’accord MLN met en avant des éléments écologiques pour mieux masquer son impact environnemental global.
Les arguments « verts » de Pertamina
Pertamina souligne que le bloc MLN comprend 58 panneaux photovoltaïques générant 1 141 kWh par an, permettant une réduction des émissions de CO2 de 7 507 tonnes par an . La compagnie présente cela comme « une manifestation concrète de son ferme engagement à réduire les émissions de carbone » .
Une réalité moins reluisante
- Exportation de GPL : La construction d’une usine de GPL destinée à l’exportation indonésienne signifie que l’Algérie se prive d’une énergie relativement propre pour son usage domestique.
- Dépendance maintenue aux hydrocarbures : Loin de représenter une transition énergétique, cet accord verrouille l’économie algérienne dans un modèle extractiviste pour les 35 prochaines années.
Géopolitique : L’Algérie, nouveau terrain de chasse des puissances émergentes
Le choix de Pertamina n’est pas anodin dans le contexte géopolitique actuel. Les analystes politiques estiment que la nouvelle loi minière « envoie un signal clair que l’Algérie est désormais ouverte aux grandes corporations mondiales, particulièrement de Chine et des États-Unis » . En s’alignant sur les intérêts stratégiques américains pour sécuriser l’accès aux minéraux rares, Alger offre ses ressources aux plus offrants dans une logique de court terme qui hypothèque son avenir.
Conclusion : Une souveraineté nationale mise à mal
Le prolongement du contrat avec Pertamina pour le bloc MLN est bien plus qu’un simple accord commercial. Il incarne une transformation profonde de la gouvernance des ressources en Algérie, marquée par l’opacité, le mépris des procédures démocratiques et la braderie du patrimoine national.
Alors que les dirigeants algériens célèbrent cet accord comme une réussite, il représente en réalité une triple capitulation :
- Capitulation politique face aux exigences des investisseurs étrangers, au détriment de la souveraineté nationale.
- Capitulation économique en privant les générations futures d’une richesse qui leur revient constitutionnellement.
- Capitulation écologique en verrouillant le pays dans un modèle extractiviste pour 35 années supplémentaires.
Comme le résument si bien les partis d’opposition algériens, « pourquoi le pays devrait-il être privé d’une richesse inestimable qui pourrait protéger les générations futures ? » . La question mérite d’être posée, même si dans l’Algérie d’aujourd’hui, poser cette question peut conduire en prison.